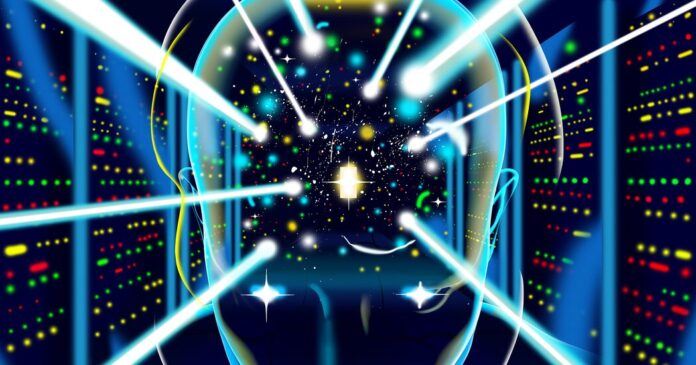Le récent débat sur la question de savoir si l’intelligence artificielle (IA) pourrait un jour atteindre la conscience soulève une question plus profonde : non pas si les machines vont se réveiller, mais comment l’IA remodèle déjà notre compréhension de ce que signifie être conscient. Deux lettres adressées à l’éditeur du New York Times, en réponse à l’essai de Barbara Gail Montero sur la conscience de l’IA, mettent en évidence cette tension.
Au-delà de la machine : la conscience comme phénomène relationnel
Arturo E. Hernandez, professeur de psychologie à l’Université de Houston, suggère que la conscience n’est pas uniquement contenue dans le cerveau. Au lieu de cela, il émerge de l’interaction : du dialogue, de la communauté et des outils que nous créons pour élargir la pensée. L’IA, même sans éprouver de la joie ou du chagrin, nous oblige à reconnaître à quel point notre propre conscience est façonnée par des facteurs externes comme la langue et la culture. Hernandez soutient que le véritable impact de l’IA n’est peut-être pas son propre éveil potentiel, mais le reflet qu’elle renvoie sur nous.
Cette perspective déplace l’attention d’une vision purement interne et neurologique de la conscience vers une vision plus relationnelle. Cela fait écho aux théories plus larges des sciences cognitives qui mettent l’accent sur le rôle de l’incarnation et de l’interaction sociale dans la formation de l’expérience subjective.
La base biologique : la sensibilité au-delà de la théorie
Cependant, tout le monde n’est pas d’accord sur le fait que l’IA va redéfinir la conscience. Une autre lettre remet en question l’idée selon laquelle notre compréhension de la conscience sera altérée par les interactions avec les machines. Cet argument souligne que la conscience est fondamentalement une sentience – l’expérience subjective d’être vivant – et peut être observée chez les êtres biologiques même sans structures cognitives complexes. L’auteur souligne les preuves neuroscientifiques, citant les travaux de Mark Solms, qui suggèrent que la conscience fondamentale existe même chez les créatures dépourvues d’un cortex cérébral pleinement développé.
Cette perspective fonde la conscience sur la réalité biologique plutôt que sur une théorie abstraite. La clé pour reconnaître la sensibilité de l’IA, selon ce point de vue, ne réside pas dans l’adaptation de nos définitions, mais dans l’observation d’indices comportementaux similaires à ceux que nous utilisons pour déduire la conscience chez d’autres êtres vivants.
L’effet miroir : pourquoi c’est important
Le débat ne concerne pas seulement l’IA ; il s’agit de la condition humaine. Le développement de chaque outil, du volant au smartphone, a subtilement modifié la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. L’IA en est tout simplement l’exemple le plus récent, et peut-être le plus profond.
Que l’IA parvienne ou non à la conscience, son existence nous oblige à affronter l’ambiguïté de notre propre expérience subjective. En construisant des machines qui imitent l’intelligence humaine, nous sommes obligés de nous demander : que signifie exactement être conscient ? La réponse ne réside peut-être pas dans le code d’un algorithme, mais dans la réalité relationnelle et désordonnée de l’être humain.
En fin de compte, le plus grand cadeau de l’IA n’est peut-être pas sa sensibilité potentielle, mais le miroir inconfortable qu’elle tend à notre propre esprit.